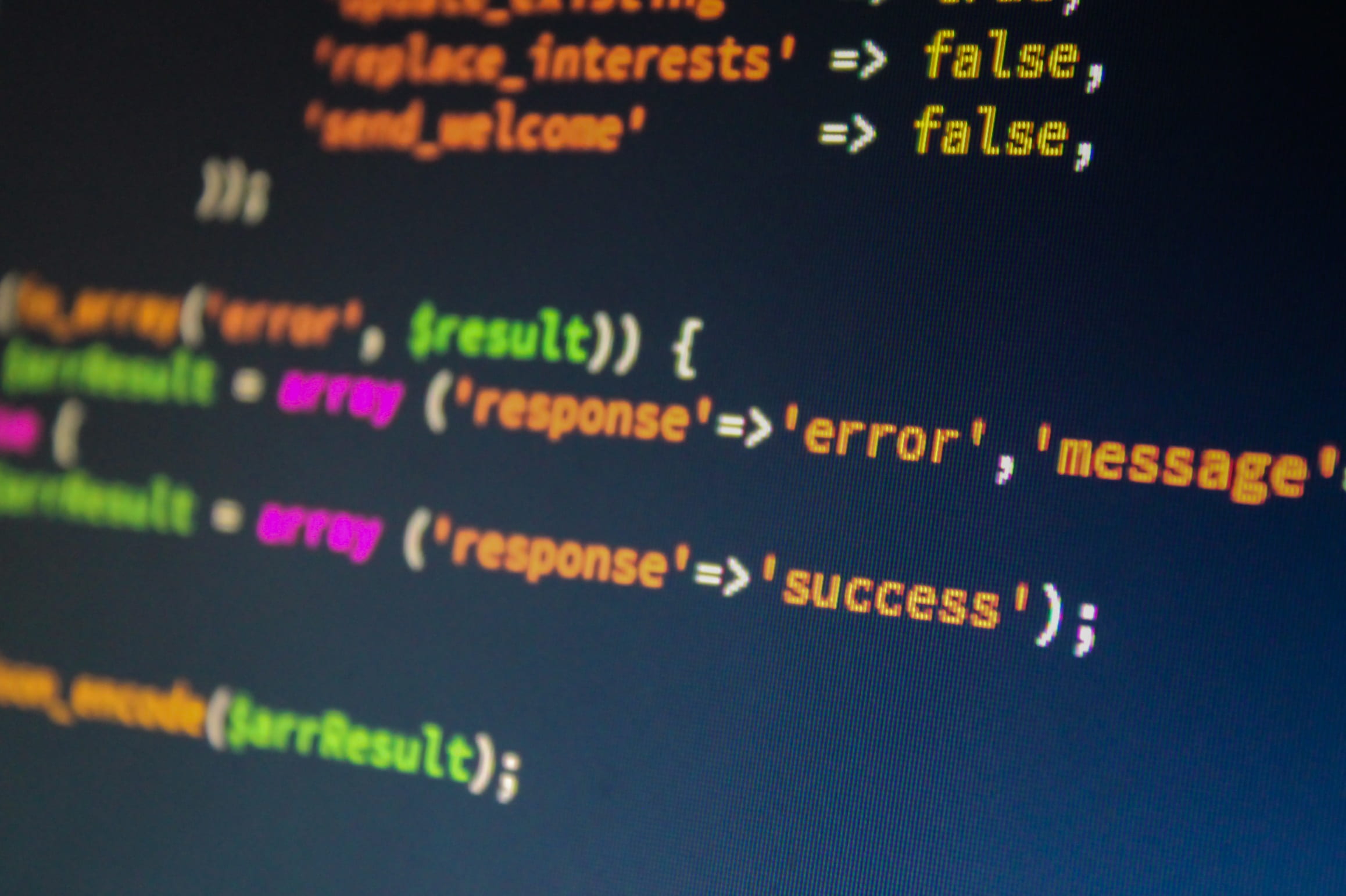Zoom sur le métier de restaurateur·rice d’œuvres numériques
Article publié le 25/03/2024
- #RETEX
Temps de lecture : 5min

© S. Bianchini
Sylvie Tissot multiplie les métiers : fondatrice de l’entreprise Anabole, professeure en programmation dans des écoles d’art et de design, chercheuse notamment sur les sujets de vulgarisation de calcul quantique, elle est aussi artiste au sein du collectif DataDada qui aborde de façon décalée certains enjeux numériques. Depuis 5 ans, elle se spécialise également dans la restauration d’œuvre numérique. Un apprentissage de terrain qu’elle documente régulièrement. Quelles œuvres sont les plus difficiles à restaurer ? Avec quels outils ? Pour quel budget ? Sylvie Tissot nous livre les coulisses de sa discipline…
Sur quel type d’œuvre travaillez-vous ?
Sylvie Tissot : Les premières pièces sur lesquelles je me suis penchée sont celles d’Albertine Meunier. Par exemple, sa pièce L’Angelino est connectée à Twitter ; il faut explorer les nouvelles API de la plateforme, calibrer le flux d’informations par rapport ce qui existait à l’époque où l’œuvre a été produite. Il peut aussi s’agir d’œuvres en ligne, du net art, comme celles que j’ai restaurées pour l’association Synesthésie. En 2022, j’ai travaillé sur l’installation Poursuite de Samuel Bianchini. C’est un projecteur de lumière qui effectue une forme de danse à l’intérieur d’architectures. J’avais travaillé sur le développement de cette pièce en 2014 et il a fallu la restaurer dans le cadre d’une démonstration pour le festival accès)s(. Les technos n’existaient plus, les connecteurs pour piloter la lumière non plus.

Nous avons également, à l’occasion d’une soirée sur l’IA à l’Université Paris Dauphine, greffé sur la pièce une composante IA : ainsi, les gestes produits par faisceaux lumineux avaient fait l’objet d’un apprentissage machine. J’ai aussi travaillé sur d’anciennes bornes interactives, notamment pour le musée de la moutarde. À l’époque, les gens pouvaient se prendre en photo dans des environnements liés à la moutarderie. 10 ans plus tard, les technos ont changé, ainsi que le cadre juridique : le RGPD est passé par là. Il a fallu restaurer la pièce en respectant le cadre légal.
Qui peut faire appel à vos services ?
Toute personne physique ou morale qui détient une pièce numérique qu’il souhaite restaurer. Je suis engagée depuis des années dans la préservation de ce type de patrimoine et j’en ai profité pour documenter ma démarche. Je me suis rapprochée de chercheurs à l’école du Louvre, qui ne travaillent pas du tout sur des œuvres numériques, pour connaître leur méthodologie, la façon dont ils documentent, dont ils établissent des fiches de restauration. Par exemple, j’ai intégré le fait de préserver certaines parties de l’œuvre originale dans ma manière de reprogrammer. Je fais en sorte de garder des traces de l’architecture technique initiale, de la mettre à jour sans dénaturer. De la même manière, je simule les interfaces graphiques pour respecter ce qu’elles étaient au départ. Comprendre le contexte technique et social – par exemple ce qu’était le réseau et ses problématiques du temps du minitel – représente beaucoup de travail. C’est une approche pluridisciplinaire et j’essaie de trouver des partenaires avec qui il y aurait une articulation de ce qui est de l’ordre de l’archéologie des médias et de la technique mobilisée.
Y a-t-il des technologies plus pérennes que d’autres ?
Depuis des années, je fais le pari que les techniques du web (html, javascript, css) sont les plus pérennes, quand bien même la pièce ne tournerait pas sur Internet. À une époque, on a beaucoup utilisé Flash et Director. Ils n’ont pas résisté au temps pour des raisons techniques, marketing, et d’accords qui ne se sont pas faits. En revanche, le html et les techniques utilisées pour la diffusion dans les navigateurs durent depuis les années 90. En termes de restauration, ça représente parfois beaucoup d’efforts parce ce n’est pas toujours adapté, mais on espère que dans dix ans, l’œuvre vivra encore sa vie. Par exemple, les trois pièces de Synesthésie sont du net art, donc conçues à l’origine pour le web. Pour la restauration, j’aurais pu utiliser des techniques d’implémentations actuelles mais le web évolue et dans dix ans certaines techniques n’existeront plus. En revanche, certaines balises existent depuis le début. Je m’appuie donc sur des techniques qui ont fait preuve de leur pérennité pour restaurer de manière assez frustre – le code n’est pas très évolué – mais robuste.
A contrario, y a-t-il des technologies qui risquent de devenir rapidement obsolètes (lire l’article Obsolescence technologique vs. oeuvres numériques) ?
Dès lors que de nouvelles techniques émergent, des objets tels que la VR, on peut supposer que ça peut durer un temps donné, ou au contraire que ça va évoluer et devenir plus pérenne. Je pense qu’il faut assumer le côté éphémère des techniques sur lesquelles reposent ces œuvres. C’est comme du land art : une pièce a une certaine signification à un temps donné, puis n’existera plus. Ce sera alors la documentation qui fera foi.
Les artistes anticipent-ils·elles suffisamment la conservation et la restauration de leur art numérique ?
Il ne s’agit pas que des artistes, c’est aussi le rôle des institutions culturelles. Le budget alloué à la restauration et la préservation n’est pas anticipé dans la production de l’œuvre. Il y a beaucoup de budget pour fabriquer la pièce, très peu pour la restaurer.
Combien coûte et combien de temps prend une restauration d’œuvre numérique ?
Tout dépend de l’œuvre. Une première exploration permet de déterminer le temps qu’on va y passer. Je fais une grille de lecture pour savoir combien il y a de fichiers – dans une œuvre de net art, ça peut tenir sur un fichier comme sur 250. Ensuite, est-ce que le script utilisé est facile à lire ou pas ? Quand on fait appel à du Flash, est-il facile de récupérer les éléments ? Y a t-il des scripts malveillants ? Il y a beaucoup de critères.
Quels outils utilisez-vous ?
J’ai des outils de production web. Un éditeur (PHPStorm) de fichiers html, css et javascript. Pour récupérer le Flash, comme on ne peut plus le lire dans un navigateur, je dispose de deux outils : Animate, qui a succédé à Flash et avec lequel je peux ouvrir les fichiers et voir comment ils sont structurés ; et une plateforme RuffleS, qui permet de faire tourner des pièces comme si on les ouvrait dans un navigateur. Ce dernier outil a été développé par une communauté de gens qui ont à cœur de continuer à lire des pièces obsolètes développées sous Flash. J’ai aussi une très vieille version de Director qui fonctionne toujours. J’aimais bien cet outil car la promesse était de produire du multimédia, c’est-à-dire d’intégrer n’importe quel média y compris ceux qui n’existaient pas encore. Cette promesse a été tenue. Je fais un parallèle avec la technique web du responsive : le fait de pouvoir faire tourner une page web sur un ordinateur, un mobile, une tablette… Le contenu est adapté selon la plateforme et cela anticipe des supports qui n’existent pas encore : des télés connectées ou des casques de VR, par exemple.
Quelle est l’œuvre qui vous a donné le plus de fil à retordre ?
Tout ce qui est connecté à des API. Par exemple, des œuvres qui permettent de récupérer des images d’Instagram à partir d’un hashtag et de les transformer, de les diffuser dans l’espace. Toutes ces pièces sont fragiles. Les stratégies d’API de ces réseaux et les autorisations et clés d’accès changent. On est très dépendant du contexte technique et marketing de ces plateformes.
Avez-vous un conseil pour les artistes qui voudraient assurer la pérennité de leurs œuvres numériques ?
Il faut documenter la pièce dans tous ses aspects : la démarche, la manière dont elle a été conçue, implémentée, dont elle a été montrée (captations vidéo, screenshots d’écrans…). Si la pièce tombe en panne, on a alors une trace et on peut recoller les éléments.
Rédaction Elsa Ferreira
Newsletter
Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.