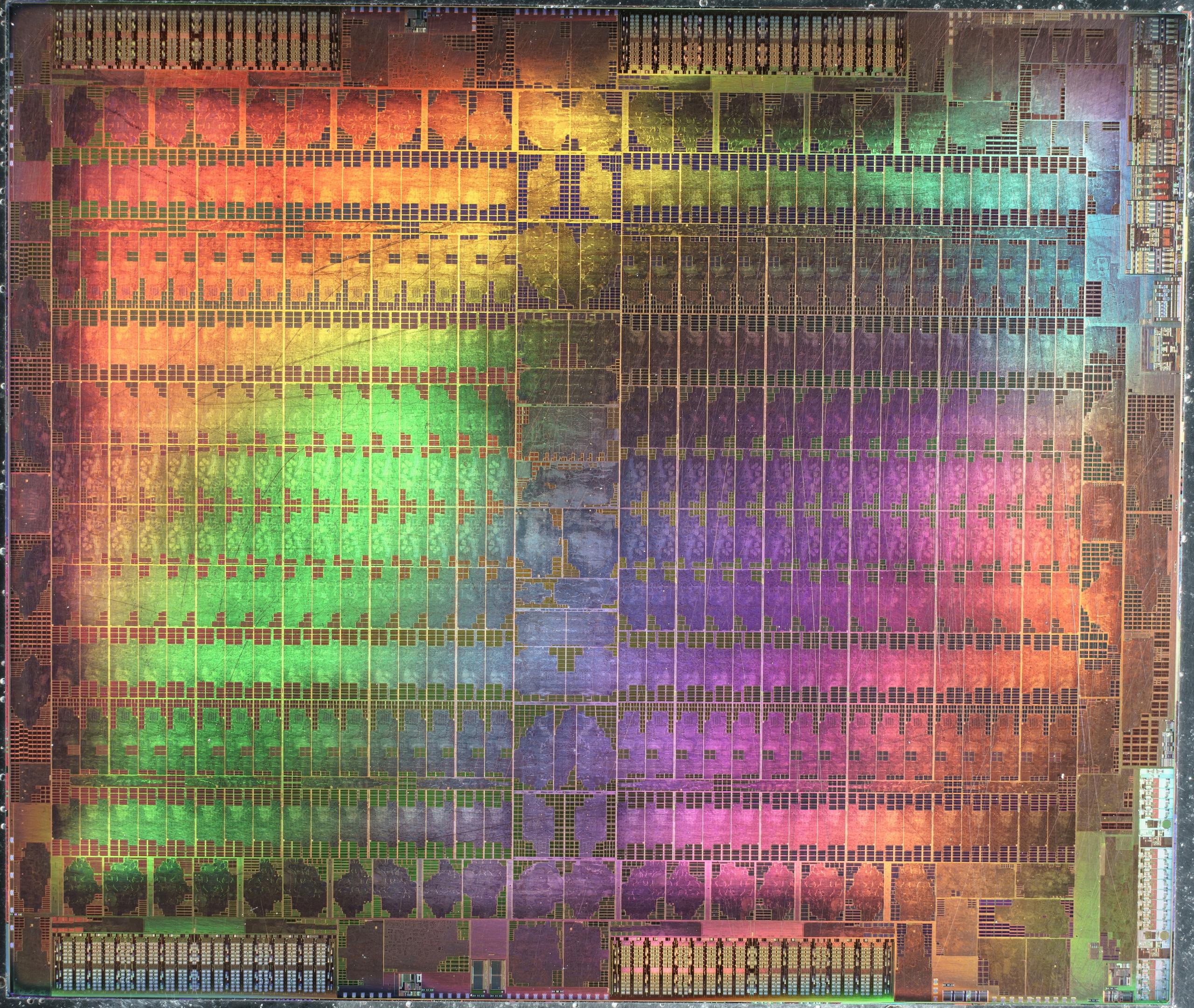L’hybridation, l’endroit des affranchi·es ?
Article publié le 31/03/2025
- #AMBIVALENCES
Temps de lecture : 6 min

INVIVO 24.7 – © Nicolas Richard
Ici et là, on le voit désigner des spectacles, des expériences culturelles et des démarches artistiques : le mot « hybridation » est tout aussi clair que flou, du fait des immenses possibilités qu’il suppose. Et si c’était précisément cela qui était recherché par les artistes et structures y faisant référence ? Mais alors quelles formes prend cette hybridation ?
Plus communément, l’hybridation est un mot des sciences de la vie, usité en agriculture, botanique ou encore zoologie. À cet endroit, il désigne « le croisement entre deux variétés, deux races d’une même espèce ou entre deux espèces différentes ». Pour aller plus loin, le latin hybrida signifie ‘sang mêlé’, ce croisement donnant lieu à « la naissance de spécimens réunissant, à un degré plus ou moins marqué, des caractères spécifiques des deux parents ». Un croisement qui permet in fine « d’exploiter certaines qualités » appartenant à des entités différentes. En art, ces croisements ont-ils aussi pour objet de tirer le meilleur de chaque espace, discipline ou technique ?
Les différentes typologies d’hybridation dans l’art
Sans avoir la prétention d’être exhaustif·ves – tant le sujet est en perpétuelle mutation – nous pouvons identifier plusieurs formes de cette hybridation dans le champ artistique.
La première s’attache à croiser les disciplines artistiques (théâtre, danse, arts visuels, musique…) et parfois les typologies d’expériences – réelles et virtuelles. À cet égard, le Collectif INVIVO, qui « crée des spectacles hybrides aux frontières du théâtre, des arts immersifs et des arts numériques », affirme ce positionnement. Pour Julien Dubuc, en charge de la direction artistique, il s’agit avant tout d’ « explorer de nouveaux médiums afin de trouver la meilleure forme pour raconter une histoire ». Celui qui se définit comme artiste multiple – touchant aussi bien à la création lumière et vidéo qu’à la mise en scène – explique par ailleurs le désir du Collectif, dès les premières créations, de sortir du clivage voire de la hiérarchie artistique / technique. Ce mot ‘hybride’ n’a pourtant rejoint leur description qu’en 2021, depuis la création Les aveugles, dans une volonté de « donner à imaginer une autre forme un peu inédite ». Avant cela, c’est le terme ‘théâtre immersif’ qui était utilisé pour définir les spectacles du collectif « puis ce mot a été accaparé par le champ de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte » venant gommer, selon Julien Dubuc, le sens premier « d’être au cœur d’une expérience ». Derrière ce terme ‘hybride’, INVIVO défend ainsi des spectacles tels que 24/7 mélangeant réel – sous la forme d’une mise en scène théâtralisée avec interprètes au plateau – et proposant aux spectacteur·ices, en simultané, une expérience en réalité virtuelle.
En 2026, le Collectif proposera un autre type d’hybridation tandis que son projet Rabbit hole prendra corps en deux formats, mélangeant chacun des espaces réels et virtuels : un spectacle immersif et une application interactive. À travers ces créations, Julien Dubuc défend « la liberté d’aller piocher un peu partout en termes de références, de médiums et de disciplines artistiques » et de croiser les regards artistiques.
Une autre typologie d’hybridation a trait aux espaces. La SAT (Société des arts technologiques) de Montréal y a consacré un dossier en août 2024, dans le cadre de sa collaboration avec Moment Factory. Déclenchés par la covid-19, dans le contexte d’une forte réduction de l’offre culturelle in situ, ses premiers projets « d’espaces connectés » ont constitué une nouvelle offre. Et si le dossier concède que « la plupart des offres culturelles en ligne n’ont pas été renouvelées » au « retour à la normale », il note cependant que « la pandémie a profondément modifié les habitudes de consommation culturelle des spectateur·ices, rendant difficile le renouvellement des publics ». À cela se sont ajoutées des contraintes supplémentaires telles que des coûts de production plus élevés et une préoccupation inévitable quant à l’impact environnemental des tournées. Pour y répondre, l’un des défis de la SAT est aujourd’hui « d’imaginer de nouvelles formes de performances convaincantes qui combinent des nouvelles pratiques avec les approches traditionnelles ». La création d’expériences artistiques hybrides, du point de vue des espaces, leur apparaît alors comme un moyen de garantir une circulation mondiale des œuvres tout en préservant une certaine physicalité des performances, mais aussi de permettre la collaboration entre des créateur·ices géographiquement éloigné·es. Une des pistes explorées est celle d’une hybridation entre espace physique et virtuel afin de « réinventer les formes de communautés spontanées du public, sans que les spectateur·ices soient nécessairement présent·es dans le même espace physique que les performeur·ses ». La SAT explore par ailleurs d’autres formes de configurations hybrides, comme avec la pièce Présence d’Antoine Saint Maur réalisée dans Satellite (sa plateforme webXR libre) : une expérimentation en direct dans laquelle des acteur·ices holographiques rencontrent leur public virtuel.
L’enjeu pour la SAT est de « créer un sentiment de télé-coprésence convaincant » afin que « la réalité résultant de la combinaison de différents lieux [soit perçue] comme une nouvelle réalité unique ». Il faut pour cela donner la sensation aux performeur·ses de partager le même espace et la même performance, tout en créant une connexion émotionnelle du public avec l’œuvre et les autres spectacteur·ices.
Troisième axe d’hybridation possible : celui des lieux et donc des publics. Par la recherche d’une plus grande porosité entre les milieux, certaines structures allient l’art avec des domaines parfois fort éloignés. L’exemple du 3 bis f, situé dans le Centre Hospitalier psychiatrique Montperrin à Aix-en-Provence, est particulièrement innovant. Des artistes y sont invités, plusieurs fois par an, dans le cadre de résidences permettant des temps de rencontre avec les publics de l’établissement en parcours de soin. Disposant d’une salle de spectacle et d’une salle d’exposition, il devient en 2021 un Centre d’art contemporain d’intérêt national – le seul à être relié à un établissement de santé.
Une autre forme d’hybridation entre lieux et publics se développe tandis que « les « caractéristiques naturelles » des territoires tendent à devenir des sources d’inspiration, de création et des lieux de diffusion ». Un article de l’Observatoire des politiques culturelles prend ainsi pour exemple Le Partage des eaux de David Moinard, cent kilomètres de parcours artistique à ciel ouvert traversant le Parc des Monts d’Ardèche. On y trouve une série d’œuvres issues de différentes disciplines artistiques (sculpture, design, vidéo, paysagisme) s’articulant aux lieux patrimoniaux et culturels du territoire. À destination d’un public de randonneurs locaux ou venus intentionnellement, « cette proposition permet donc d’aller au-devant des marcheurs, de faire « bouger » et marcher le public. Il promeut une autre connexion à l’art, à la création et à l’environnement, car il leur associe une réflexion sur les paysages » analyse Claire Delfosse, géographe et directrice du laboratoire d’études rurales, autrice de cet article.

Elle y cite par ailleurs d’autres exemples d’endroits réhabilités en lieux culturels soulignant que « ces lieux non dédiés font venir des publics qui ne franchiraient pas le seuil d’un « haut lieu » culturel et facilitent leur participation ». Elle voit dans l’émergence et le développement de ces tiers-lieux, caractérisés par leur multifonctionnalité et leur hybridation (bibliothèques, salles des fêtes, cafés, librairies, salle d’exposition, lieu de diffusion..), une opportunité de développer l’accès à la culture dans les milieux ruraux, . Elle cite par ailleurs une étude conduite en Nouvelle-Aquitaine qui montre « que la quasi-totalité des tiers-lieux qui se développent en milieu rural ont une offre artistique et culturelle : expositions, plus rarement ventes de paniers culturels, spectacles-concerts, résidences d’artistes ou festivals ».
L’hybridation comme marqueur d’une singularité
Ces différentes formes d’hybridation peuvent être perçues comme le reflet d’une volonté actuelle de « s’affranchir des logiques d’assignation », comme l’exprime Céline Berthoumieux, déléguée générale du réseau HACNUM. Le Réseau national des arts hybrides et cultures numériques revendique en effet de rassembler une somme d’entités non-conventionnelles. Et si cela pose encore parfois question en France, face à des politiques culturelles très sectorisées, la réception à l’étranger de cette démarche est plus évidente – « où la question de la « pureté » de la discipline est moins présente » exprime-t-elle. Elle y définit alors HACNUM comme « la réunion des artistes et structures qui ne se sont pas reconnu·es dans les cadres établis jusqu’alors et qui viennent ici entretenir leur singularité ». Pour Julien Dubuc, l’hybridation recouvre aussi une notion de « plasticité » permettant d’ouvrir largement le champ des possibles pour imaginer des croisements et collaborations sans cesse renouvelés. Elle est un espace de liberté, définissant mieux encore la démarche artistique que la notion d’arts numériques « qui pâtit encore de certains écueils et a priori ». La réalité virtuelle, par exemple, est encore souvent perçue par les publics et personnes en charge de la programmation comme un repoussoir avec la crainte « que l’outil technologique mette à distance de l’œuvre ». Accoler plusieurs mots et utiliser le terme de spectacle hybride se veut alors rassurant.
Témoin de l’évolution de nos sociétés, « l’art est tout autant le parfait témoin des apports opérés par diverses civilisations en contact les unes avec les autres et le créateur de nouvelles visions esthétiques et culturelles. » N’est-il donc pas le propre de la création d’être le fruit d’une hybridation, de plusieurs influences et de plusieurs volontés ? Pourtant, « quel que soit le champ de leur apparition, les hybrides advenus posent le problème de leur nature, de leur statut et imposent d’interroger leur temporalité incertaine, leur situation par rapport à une entité de départ aux contours flous » évoque Michael Werner dans un colloque intitulé « L’art, entre création et hybridation ». À méditer…
Rédaction Julie Haméon
| L’autrice de l’article Journaliste indépendante spécialisée en politiques culturelles, Julie Haméon collabore régulièrement pour plusieurs médias (La Scène, La Lettre du spectacle, HACNUMedia, l’Observatoire des politiques culturelles…). Elle y traite notamment des enjeux liés à la transition écologique dans le secteur culturel. Basée à Nantes, sa formation mêle journalisme, médiation et sciences politiques. Ayant travaillé dans le secteur culturel pendant une quinzaine d’années, elle est particulièrement attentive aux sujets qui se situent à l’intersection des arts, des sciences sociales et des politiques publiques. Elle est également autrice et réalisatrice de podcasts. |
Newsletter
Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.