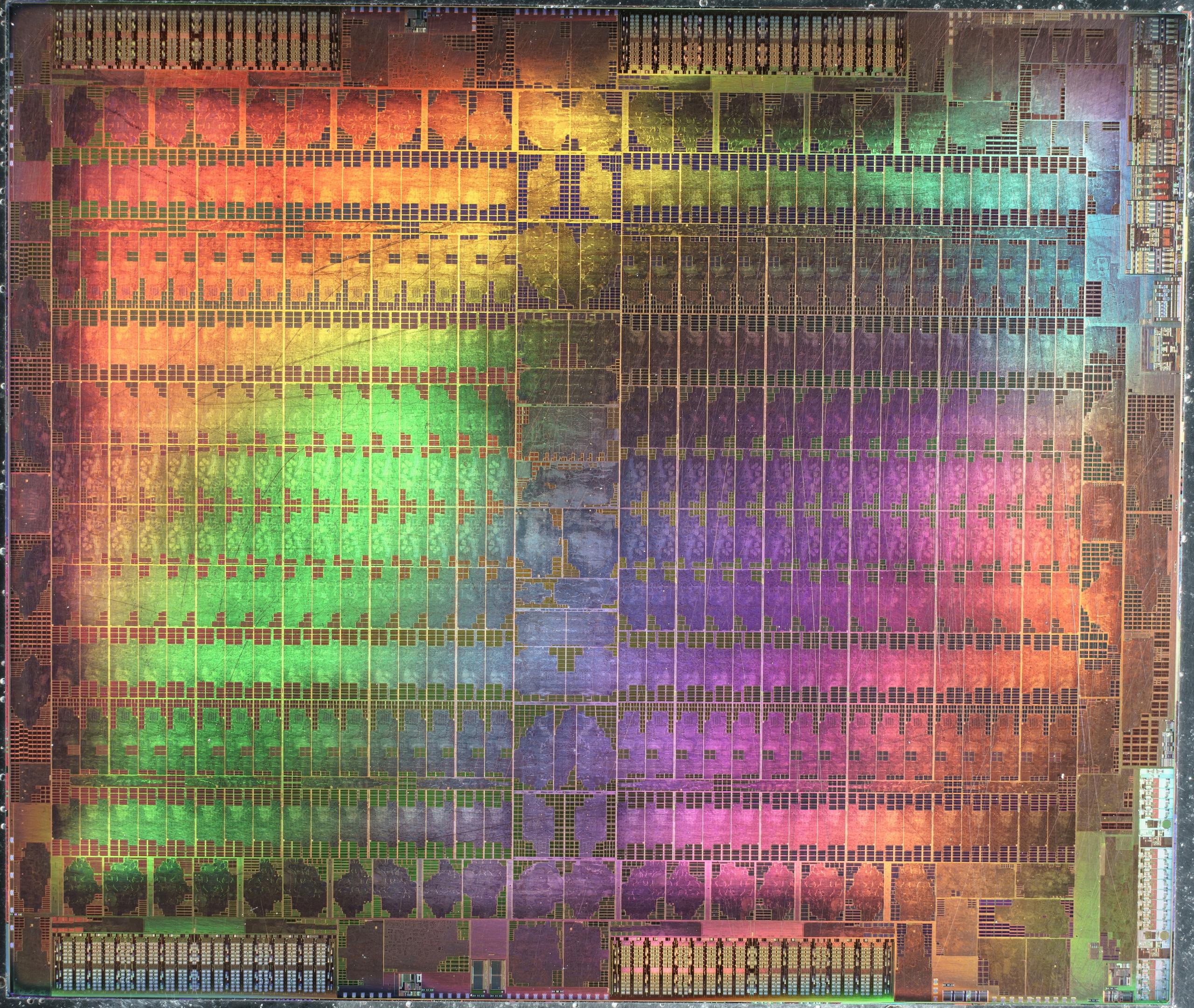Les cultures numériques, un levier de transmission auprès des jeunes générations
Article publié le 07/07/2025
- #RETEX
Temps de lecture : 4 MIN

© Le Safran
Quelles stratégies de médiation permettent de nouer un lien avec les jeunes générations, parfois éloignées de l’offre culturelle de leur territoire ? Les cultures numériques peuvent-elles devenir un levier d’émancipation, de participation et d’accès à l’art ? Gros plan sur quelques initiatives qui n’hésitent pas à mobiliser des moyens financiers et humains et font une démonstration implacable : à l’ère du numérique, l’éducation artistique et culturelle ne saurait être reléguée au rang de variable d’ajustement.
Quelque 100 professionnel·les de la culture se sont donné·es rendez-vous en juin à l’occasion du festival Constellations organisé par la Ville de Metz et le tiers lieu BLIIIDA. Sur le programme, le fil conducteur est bien balisé : CTRL + ART + EDUC, ou comment, dans un monde numérique, repenser l’éducation artistique et culturelle (EAC) à destination des jeunes générations. L’objectif ? Ne pas se contenter du discours sur un numérique supposément “connectant”, mais interroger les besoins réels de médiation et la manière dont les structures culturelles adaptent leurs dispositifs aux usages et attentes des nouvelles générations.

Rester au contact des pratiques numériques
Plusieurs projets témoins placent ainsi les publics au cœur même de la transmission. Valérie Perrin, responsable du Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) de l’Université de Haute-Alsace, partage les lignes du nouveau projet culturel intégré au campus universitaire. Ici, la création numérique doit être un moyen de rester au contact des jeunes générations. “Nous avons choisi de débuter ce projet avec des œuvres en réalité augmentée, notamment avec le travail de Guillaumit. La réalité augmentée nous permet de contourner plusieurs obstacles : elle garantit l’accessibilité des œuvres à toute heure, dans des espaces extérieurs et gratuitement à partir d’un smartphone. C’est sur cette base que nous déployons nos médiateur·rices qui sont eux-mêmes des étudiant·es du campus.”

S’adapter aux spécificités du territoire
Un écho à la politique du Safran, scène conventionnée à Amiens, qui organise depuis 2016 les Safra’Numériques (festival consacré aux cultures numériques). Le Safran a ceci de particulier qu’il est situé dans un quartier populaire en mutation notamment avec l’arrivée récente de la faculté. Ikbal Ben Khalfallah, directeur de la structure, partage sa volonté “d’amener les jeunes du quartier vers d’autres imaginaires numériques et, en parallèle, que le festival résonne avec son territoire”. D’un côté, une partie de la population qui vit la fracture numérique comme une réalité ; de l’autre, la présence d’écoles supérieures autour du numérique (IUT, école de design…) ; entre les deux, des jeunes déjà adeptes du numérique. Le Safran assume sa mission : toucher sensiblement ses publics à travers des expositions ou des ateliers, le tout accompagné de médiateur·rices. “Nous avons près 4 permanent·es en médiation à l’année pour le Safran et 80 médiateur·rices lors des Safra’Numériques”. Des moyens conséquents à l’échelle de la structure – “près de 25% du budget du festival” confie Ikbal Ben Khalfallah – et qui illustre un enjeu moins visible : la nécessité de travailler la médiation sur un temps long.
La médiation, un travail au long cours
“Dans ces conditions, la variable d’ajustement budgétaire ne peut pas être la médiation. Il faut penser les activités annuelles et le festival comme un continuum” affirme Ikbal Ben Khalfallah. Cette volonté de travailler sur une période longue est partagée par Tiphaine Huet et Lucie Olivier, de la cellule Transmission 360° de l’Ososphère à Strasbourg, qui affirment que “les dispositifs de médiation ne sont pas toujours duplicables d’une structure à une autre.” Justement Transmission 360° a mis sur pied une initiative originale : créer une communauté de médiateur·rices à l’année, entièrement ouverte à qui le souhaite. “La médiation est assurée par une communauté de 150 bénévoles et donc par les publics eux-mêmes. Ça permet de s’approprier le projet artistique autrement et de sortir du rapport sachant-apprenant” détaille Lucie Olivier. En d’autres mots : recevoir, restituer, documenter et transmettre plutôt qu’éduquer.

Manipuler et créer pour s’approprier le numérique
C’est d’ailleurs dans cette philosophie que s’inscrit le travail de la Ligue de l’enseignement. Paul Oudin, délégué culturel de la fédération de Moselle, présente les ateliers numériques en direction des jeunes publics. Des petits workshops en groupes réduits où les enfants participent à toutes les étapes de fabrication d’un film – scénarios, décors, prises de vue, montage… – à l’image des ateliers de Cinés Kraftés (Guillaume Leprévost et Sarah Poulain) et du film Julia n’aime pas lire “Pour découvrir la création numérique et se sentir investi, il est intéressant d’avoir soi-même une pratique créative. On devient acteur et plus seulement spectateur. Ce qui nous plaît c’est de voir comment l’enfant peut ensuite être autonome, partage Paul Oudin, qui ajoute, la fierté d’un enfant qui présente son travail est un moteur d’appropriation du numérique.”
Des conditions de mise en œuvre complexes
Si la création numérique constitue un levier puissant de mobilisation des jeunes publics, elle s’incarne souvent dans des formes singulières (immersives, participatives, interactives) et sollicitent des technologies spécifiques (casques de réalité virtuelle, smartphones, projections monumentales…) : ces formats impliquent des modes d’accompagnement renouvelés, pensés sur mesure. Myriama Idir, cofondatrice du Prix Utopi·e et commissaire indépendante en art urbain et contemporain, contribue à une partie de la programmation du festival Constellations. Elle souligne la complexité de la présentation d’œuvres numériques dans l’espace public, insistant sur “la nécessité d’accompagner les publics en déambulation, au-delà de la simple fascination technologique suscitée par une projection monumentale, pour faire émerger un questionnement artistique”. Il s’agit dès lors de créer les conditions d’une transmission sensible et contextualisée, sans pour autant dévoiler ou appauvrir l’expérience esthétique, un équilibre parfois délicat à atteindre. C’est ce que rappelle également Antonin Jousse, artiste visuel, chercheur et enseignant à l’École Supérieure d’Art de Lorraine à Metz : “La frontière entre présenter une œuvre et l’expliquer peut être ténue. Le rôle de l’artiste est aussi de veiller à ce que l’invitation à vivre une expérience artistique soit limpide, intelligible. Ce qui ne saurait toutefois se substituer à un véritable dispositif de médiation.” Enfin, Jean Boillot, directeur artistique de la compagnie La Spirale et de la Villa Mosellane (actuellement en préfiguration), met en lumière un élément propre aux cultures numériques : “Aujourd’hui, les formes artistiques intégrant le numérique sont multiples, quasi infinies. Cela impose de penser à chaque fois une médiation et une présentation singulières, adaptées à chaque œuvre et à chaque contexte. C’est un défi majeur pour les structures de diffusion.”
Un défi qui mérite pleinement d’être relevé : car participation et accès à l’art ne pourront advenir sans l’articulation étroite du numérique et de la médiation. Les deux étant désormais intrinsèquement liés.
Rédaction Adrien Cornelissen
| L’auteur de l’article Au fil de ses expériences, Adrien Cornelissen a développé une expertise sur les problématiques liées à l’innovation et la création numérique. Il a collaboré avec une dizaine de magazines français dont Fisheye Immersive, XRMust, Usbek & Rica, Nectart ou la Revue AS. Il coordonne HACNUMedia qui explore les mutations engendrées par les technologies dans la création contemporaine. Adrien Cornelissen intervient dans des établissements d’enseignement supérieur et des structures de la création. |
Newsletter
Retrouvez tous nos articles directement dans votre boîte mail en vous abonnant gratuitement.